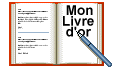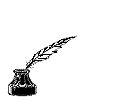L'apprenti potier
L’apprenti potier
|
D |
ans le cœur de l’usine, des klaxons de voitures sortis de la radio, répondaient en écho aux « Zip » et « Pfaff » rythmés de la presse hydraulique.
« Zip, Pfaff - Zip, Pfaff - Zip, Pfaff ».
En moins de deux secondes, un pot lisse, juvénile, sortait de son chapeau.
Labourey n’avait plus qu’à cueillir des deux mains la corolle argileuse, fraîche et fragile encore, la poser derrière lui sur une planche de séchage puis offrir, rapidement, à la gloutonne d’acier un nouveau colombin.
Les gestes étaient rodés, le scénario huilé comme chaque pain de terre crue que la machine, vorace, engloutissait d’un coup.
« Zip, Pfaff - Zip, Pfaff ».
Quelque six pots plus tard, Bébert prenait la planche, la portait à l’épaule d’un mouvement maîtrisé et, tel un funambule, traversait l’atelier, grimpait sur l’escabeau puis déposait sa charge sur les plus hauts barreaux de la zone de séchage.
Je n’avais dans Amance pas encore mes repères. Les vacances estivales me plongeaient quelquefois dans le désoeuvrement. De mes nouveaux copains, certains sortaient très peu ou aidaient leurs parents, pas toujours de bonne grâce. Pour d’autres, malheureusement, leur quatorzième année les avait condammnés à un travail forcé. Pas d’études ? Au travail !
Il m’arrivait parfois de mener le tracteur quand on rentrait le foin ou les ballots de paille. Mais juste en dépannage. J’n’étais pas assez mûr pour le conduire encore en toute autonomie. Témoin ce fameux jour, sur la pente de Virette, où le vieux SOM 40 se prit à s’emballer.
Ma mission était simple. Avancer le tracteur d’un tas de foin à l’autre, puis l’immobiliser pendant le chargement. Mais la charge augmentant, la poussée dans la pente devenait bien plus grande ! Simplement débrayer devint insuffisant pour stopper le convoi. Fallait serrer les freins.
Du haut de mes treize ans, je jetai toutes mes forces sur les pédales jumelées. Mais ce fut peine perdue. Le tracteur s’emballait.
Et la remorque de foin qui poussait, qui poussait.
Et mon père qui criait « Tire sur le frein à main ! » .
Et ma mère qui hurlait.
J’étais tétanisé.
Puis tout s’accéléra. En moins de deux secondes, mon père jeta sa fourche, sauta sur le tracteur en passant par l’arrière et tira violemment sur ledit frein à main.
Le SOM 40 stoppa !
Cette brève mésaventure mit fin, provisoirement, à mes courts CDD. Trop rapidement, hélas, l’histoire fut oubliée. On sut me rappeler…
Au début de l’été, je m’étais infiltré dans l’univers glaiseux de la poterie Drouilly. Par simple curiosité.
Dans cette usine, fondée par un potier « grètier » venu tout droit d’Alsace bien avant 1900, je retrouvais un monde en tous points comparable à la fabrique de briques de Monsieur Piétremont. Ici c’était les pots qui occupaient l’espace. Grands, petits, crus ou cuits, ils peuplaient les locaux, et l’extérieur aussi, dans toute leur multitude.
D’abord observateur, j’y jouai finalement des petits rôles ponctuels, taillés à la mesure de ma musculature qui peinait, je l’avoue, à sortir de l’enfance.
Ce jour là, j’ébarbais les pots partiellement secs attendant la cuisson. Il était très fréquent, au sortir de la presse, que leur col soit couvert de barbilles argileuses qu’il fallait retirer à l’aide d’une petite lame.
Dès lors, le pot imberbe retournait sur sa planche, mais la base vers le haut pour finir son séchage.
Du séchoir, c’est Jean-Claude qui descendait les planches.
Jean-Claude, c’était le boss. Il avait succédé à son père Etienne, défunt en 44, et poursuivi, comme lui, la poterie horticole. Jean-Claude, un homme jeune, dynamique et moderne. Un homme indépendant, parfois détaché du monde qui l’entourait, mais un cœur généreux.
Amoureux, à l’excès, de la belle mécanique, il aimait au volant prendre des risques inutiles. Dérapages contrôlés, virages au frein à main, étaient ses favoris.
J’ai encore en mémoire l’entrée spectaculaire de sa Renault bordeaux dans la cour Derémond.
Blocage des roues arrière, braquage des roues avant,
la voiture dérapait ;
Rétrogradage rapide puis accélération,
La voiture se garait.
Sur leur support étroit, les jeunes pots pubescents frissonnaient quelque peu mais gardaient l’équilibre. Il arrivait, hélas, que l’un d’entre eux bascule. Certainement mal centré par les mains trop confiantes de Monsieur Labourey, que l’habitude du geste trahissait quelquefois, le pot déshydraté, privé de l’adhérence, perdait de son aplomb et chutait lourdement.
« M…. ! »
« Allez ! Tout le monde descend ! ».
Des éclats de mots crus et de rires étouffés se mêlaient ça et là dans la « nef » des potiers.
Rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui valait, hier, pour Antoine Lavoisier, valait aussi, ici, pour l’apprenti potier. À chaque pot « descendu » qui manquait à l’appel, s’en suivait le ballet du seau et de la pelle. Les débris argileux étaient récupérés, broyés pour enrichir la cuve à barbotine, et les sourires moqueurs, celle de la bonne humeur.
Concentré sur ma tâche, je n’en gardais pas moins une oreille bien tendue sur les flashs périodiques d’Europe n°1.
Et la nouvelle tomba.
« Jacques Anquetil est lâché ! »
L’info me stupéfia ! J’abandonnai mon poste pour m’approcher du poste.
Jacques Anquetil ! Décroché !
Comment était-ce possible ?
Le célèbre Chapatte s’en serait étranglé.
C’était le 11 juillet 1966, la 19ème étape du Tour de France cycliste. Chamonix - Saint-Etienne, la plus longue de ce Tour avec, en fin de parcours, le col d’la République, dit le col de Grand Bois, deuxième catégorie.
Lucien Aimar, la veille, avait su préserver sa précieuse tunique jaune dans l'étape de la Forclaz. Il était crédité d'une avance de 1'35" sur le second, Janssen, et 6'19" sur Anquetil, le quintuple vainqueur, classé seulement 8ème.
Le « chrono » n’était plus le Jacques dominateur de la première partie de mes années 60.
1966, l’année de mon certif !
Ma mère avait tenu à ce diplôme « Primaire », qui n’avait, au collège, aucune utilité.
« Si t’as pas ton brevet, tu auras toujours ça. Et puis ça te fera un petit entraînement avant l’année prochaine ! »
Le second argument finit par me convaincre.
Pour les Maths, pas de problème.
Et le Français non plus.
Quant aux programmes de Sciences, d’Histoire-Géographie, qui étaient sans rapport avec ceux du Collège, je dus m’y replonger.
« Travailler plus pour gagner plus ! »
Si le cœur vous en dit…
Sciences :
Le courant électrique peut servir à différents usages dans un ménage. Énumérez les emplois que vous connaissez et précisez les précautions qu'il faut prendre en manipulant l'un ou l'autre de ces appareils.
Histoire-Géographie :
I. Comment vivaient et travaillaient les paysans à l'époque féodale (cultures, récoltes, maisons...) ?
II. Quels sont les grands ports de pêche français ? Dire sur quelles mers ils s'ouvrent et quel genre de pêche on y pratique.
D’après les commentaires, Anquetil était souffrant. Il avait, par deux fois, fait appel aux services du Dr Pierre Dumas.
L’athlète était malade mais l’orgueil donne des forces et « Maître Jacques » revint, grâce à deux équipiers au dévouement sans faille.
Ouf !
Je repris, rassuré, mon travail de « barbier ».
Même si nombreux étaient ceux dont la sympathie allait pour son rival, le valeureux Poupou, j’éprouvais pour Anquetil, une grande admiration.
Tout ado bien pensant a un besoin d’idoles.
Les rockers, les yéyés ou les chanteurs de charme, je les aimais un peu, certains d’entre eux, beaucoup, mais pas passionnément.
Mes passions, de très loin, étaient surtout sportives. Je voyais dans le sport, l’élévation de l’âme. Les paillettes du show-biz ne scintillent dans l’olympe que d’un brillant factice.
J’avais cette propension à aimer les meilleurs, ces chevaliers sans peur dont je pensais aussi qu’ils étaient sans reproche. J’appris beaucoup plus tard que j’étais bien naïf.
Déployée en longueur, l’usine était une nef à la travée unique.
Dans la zone de séchage, des pots de tailles diverses, placés en rangs serrés sur leur planche de salut, attendaient là des jours, figés au garde-à-vous comme des soldats d’argile, que l’eau les abandonne et que le four, enfin, leur façonne, sur mesure, leur tenue d’apparat.
Quelque peu à l’écart, l’atelier primitif exhibait, ça et là, les vestiges poussiéreux d’un matériel ancien. Il était dans son jus. Fenêtres, murs et plafond étaient restés figés. On y lisait l’histoire d’une industrie passée.
C’est ici que Jean-Claude versait dans des moules creux la précieuse barbotine, cette crème en glaise très fluide de couleur chocolat qui, se solidifiant, donnait corps aux poteries obtenues par coulage. Les plâtres, très poreux, se mettaient à suer, exsudant lentement le solvant absorbé par capillarité. Lors, un dépôt croissant s’accrochait aux parois. Des jardinières, des vases, prenaient forme sous mes yeux. Dans une lente gestation.
Dehors, sous le hangar, groupés en colonnades sur des palettes en bois ou bien à même le sol, pots de dix, pots de seize, de dix-huit ou de vingt, dans leur costume rose pâle, dessinaient comme des orgues offertes au vent du nord.
Ils étaient des milliers à rêver du fleuriste ou de l’horticulteur qui viendrait les chercher.
Une porte dérobée menait dans l’aire du four, le géant aux briques sombres tout enfiévré encore de l’orgie de la veille. Il dormait, gueule fermée et bedaine redondante. Il avait fait ripaille, et sans modération, jusqu’à minuit sonné, se goinfrant de déballes comme pour la dernière fois.
J’avais eu ce soir là une permission spéciale pour seconder Jean-Claude dans cette finale nocturne de la grande chauffe du mois.
Régulièrement, le boss ouvrait la plaque de tôle. La gueule ouverte, le monstre nous crachait au visage un souffle d’air brûlant. Nous détournions la tête pour jeter les déballes dans son gosier béant. Il fallait faire très vite.
Et quand Jean-Claude, enfin, en refermait la trappe, c’était le soulagement. Trente minutes de répit jusqu’au prochain gavage.
Le feu sur nos joues rouges s’apaisait doucement.
À quelques pas du four, en feuilletant les revues étalées devant moi sur une vieille table en bois, je découvris Faizant, Sempé et compagnie. Je les connaissais peu. Mon univers, étroit, s’arrêtait aux dessins du drôle Daniel Laborde, l’auteur de Lariflette dont notre quotidien, Libération Champagne, éditait chaque jour une nouvelle aventure.
Cette toute première soirée, passée au coin du feu, fut une belle expérience. Je vécus au plus près la technique de la chauffe. Et les derniers coups d’sang du dragon séculaire.
Né au cours de l’année 1872, le vieux roi n’avait plus que quelques mois de règne. Il l’ignorait encore mais dans son dos, discrets, des travaux commençaient.
On préparait la place pour un nouveau monarque.
Corps en briques réfractaires, exosquelette d’acier, brûleurs fioul intégrés. Ce four des temps modernes dispenserait les hommes des corvées de la chauffe. Des wagonnets sur rails, un système d’aiguillage, et les pots prêts à cuire entreraient facilement dans l’estomac réduit du nouveau souverain.
Quant au vieux roi, déchu, laissé à l’abandon, il serait par la suite conduit à l’échafaud de la démolition.
Coup de théâtre sur le tour !
« Jacques Anquetil vient de mettre pied à terre ! ».
Km 213.
Sur la côte de Serrières, après la traversée du grand fleuve franco-suisse, Jacques Anquetil, distancé car victime d'une bronchite, descendait du vélo. Son directeur sportif lui passait un chandail et demandait sitôt une ambulance du Tour.
Le géant l’ignorait mais la côte de Serrières venait de terrasser le roi de la grande boucle. « Maître Jacques », « le chrono », ne reviendra jamais sur la grande course mythique qui a fait sa légende.
Cet abandon surprise, que dis-je, cette catastrophe, me peina fortement. Dès lors, à mon ouvrage, j’eus beaucoup moins de cœur.
La journée terminée, je regagnai la ferme, quelque peu dépité.
Les toutes dernières étapes de l’épopée cycliste perdirent de leur saveur, même si c’est un Français, jour de 14 juillet, qui, sur le vélodrome du célèbre Parc des Princes, exhiba la tunique à la couleur de l’or.
Je retournai souvent dans la poterie Drouilly. Sans aucun engagement, quand j’étais disponible. Jean-Claude m’y accueillait toujours avec plaisir. Il me confiait une tâche ou je le regardais.
Sous prétexte de services, c’était une aire de jeux que je venais chercher. Jouer, et pour de vrai, à l’apprenti potier, au maître de l’argile qui, d’une matière inerte, va donner vie aux œuvres à la plastique ardente.
Et quelques mois plus tard, sur la plateforme d’acier nouvellement installée, je faisais l’aiguilleur des chariots d’enfournage. Sur leur réseau de rails, ils pouvaient circuler dans le cœur de l’usine, de la zone de séchage jusqu’au ventre du four ou encore vers le quai.
Cet épisode potier de mon adolescence fut une belle aventure, une expérience unique sur deux ou trois années.
J’appréciais l’atmosphère de la poterie d’hier, son ambiance très feutrée et rugueuse à la fois.
Feutrée quand la vieille presse, rassasiée de terre glaise, nous donnait à entendre les soupirs étouffés de ses enfants d’argile.
Rugueuse quand la poussière et la boue colorée teintaient nos mains offertes et nos muqueuses nasales.
Quand ils rentraient le soir, au terme de leur journée, Labourey et Bébert ou Monsieur Derémond ressemblaient quelquefois à de vieux sioux grimés s’en revenant de guerre.
Jean-Claude s’en est allé.
Trop vite, trop tôt, trop loin. Mais dans toutes les mémoires, son ombre rôde encore.
Le nez dans ses chaussures, les mains sur les coutures d’un pantalon de toile qu’elles cherchent, nerveusement, à vouloir remonter, sa silhouette, maigrelette, dodelinante, pressée, poursuit ses va-et-vient entre sa dame brune et son palais d’argile.
Céramistes-tuiliers, du pays de l’or rouge, ils restent les derniers. En reprenant l’affaire de leur père et grand-père, en rachetant la tuilerie de Jean-Pierre Piétremont, les deux garçons Drouilly ont retroussé leurs manches pour les dynamiser.
En se diversifiant, ils ont réinvesti et conjugué l’antique - coulage de barbotine - à un four très moderne.
Vases de jardin, faïences, accessoires de toiture, médaillons en terre cuite, tuiles plates artisanales, leur production est vaste.
Jamais à court d’idées, ils ont réinventé des techniques ancestrales – de plus de 4000 ans - de la Chine impériale ou de la Rome antique.
Oyez, oyez bonnes gens !
Ils donnent dans les oyas ! Et les pots composteurs.
Arroseurs autonomes, écolos, naturels, les oyas sont des jarres, fabriquées à la main, distribuant lentement et sans la moindre perte, l’eau précieuse à nos plantes.
Quant au pot composteur, ce grand vase en terre cuite à deux compartiments, il offre aux végétaux la richesse minérale, 100% naturelle, de nos biodéchets.
Grâce à leur dynamisme, les produits fabriqués depuis plus de deux siècles au cœur de la commune ont passé les frontières et rayonnent aujourd’hui, non seulement en Europe, mais dans le Monde entier.
Les jardins du Vatican, le château de Versailles, l’ancienne chocolaterie du très célèbre Menier ; le grand marché de Sceaux ; Fontainebleau et London ; Moscou ou Brighton ; États-Unis, Turquie ; Japon et Australie… ont quelque chose en eux de mon village d’Amance.

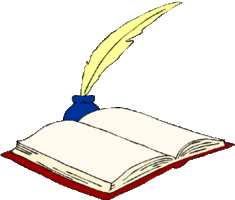 Écrits et mots dits
Écrits et mots dits